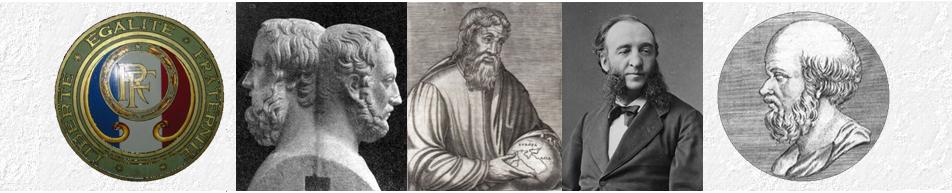Chapitre 4 : Gérer les espaces terrestres (10)
Peut-on aménager durablement les littoraux ?
C. Vers des aménagements durables ?
1°) Une nécessaire intervention politique multiscalaire :
Une photographie d’un quartier de Santa Rosa nous montre combien les aménagements sur la bande littorale ne sont pas durables. Bien que lucrative, la forte demande rend la zone non équitable (pression foncière), peu viable car l’écosystème est dégradé (érosion) et exposée aux cyclones (non vivable).
Le réchauffement climatique accentue d’ailleurs la fréquence de ces aléas naturels. Depuis 1950, le niveau moyen de la mer a grimpé de plusieurs dizaines de centimètres (fonte des banquises…), menaçant de submerger les côtes. De plus, les modifications du climat menacent les activités littorales.
Aussi, depuis l’échelle locale (manifestations de citoyens) jusqu’à l’échelle mondiale (sommet de Rio en 1992, accords de Kyoto en 1997), des actions politiques s’essaient à des aménagements durables (Loi Littoral de 1986).
2°) Un nouvel aménagement des littoraux :
Dès 1963, la France a constitué un parc national pour préserver la faune et la flore (parc du Port-Cros). En 1992, le Brésil constitue l’ARA du littoral Nord, afin de contrôler l’impact environnemental de tout projet dans la zone.
La question du choix de l’aménagement durable oppose les acteurs : le GPMH souhaiterait étendre la ZIP et agrandir le Grand canal, au détriment de la zone humide, défendue par SOS Estuaire (qui propose une alternative).
Certains aménagements se font directement sur la mer (ex. japonais de la poldérisation). Ainsi, la Norvège construit un immense parc d’éoliennes off-shore, Turbinby, dont la structure devrait servir au tourisme (spa, hôtel…).
3°) Une indispensable révolution dans le secteur primaire :
La FAO et la Banque Mondiale préconise une alternative aux ressources halieutiques surexploitées : l’aquaculture. Dans les PVD, cette activité semble viable (renouvellement), équitable (emplois) et vivable (plus de nourriture).
Toutefois, on ne saurait appliquer une solution durable uniformément, comme le montre le contre-exemple salmonicole chilien. L’espèce exogène et carnivore favorise les FMN non soucieuse du droit du travail (pas équitable), perturbe l’écosystème (pas viable) et reste vecteur de maladies (pas vivable).
L’agriculture intensive telle que pratiquée en Bretagne est responsable de marées vertes. Le système allemand Plocher propose de limiter l’apport d’engrais synthétiques donc leur coût économique, écologique et sanitaire.
Tandis que 80% des échanges mondialisés passent par les ports, une entreprise allemande a opté pour le développement de la marine marchande à voile, réduisant sa consommation en gasoil pour plus de durabilité.