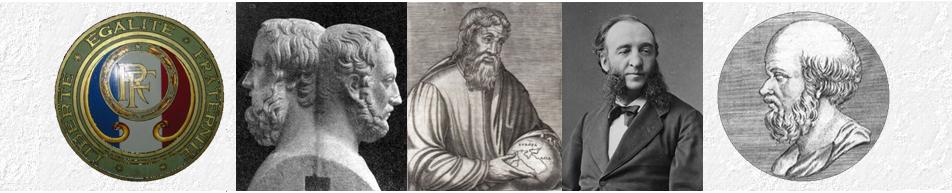Chapitre 4 : Gérer les espaces terrestres (11)
III. Espaces exposés aux risques majeurs.
Les littoraux sont-ils plus dangereux que les autres espaces ?
A. La variété des aléas.
1°) Les aléas tectoniques :
La tectonique des plaques est responsable de l’activité volcanique qui représente un aléa naturel pour les hommes (éruption et tremblement de terre) mais ne reste pas l’apanage des littoraux (cf. chaîne des Puys en Auvergne).
Les zones de collision (sud de la plaque eurasiatiques) et de subduction (ouest de la plaque américaine) sont aussi des zones sismiques. Les séismes les plus violents peuvent dépasser une magnitude de 9 (9,5 au Chili en 1960) et atteindre une intensité de 12 sur l’échelle de Mercalli (où « tout » est détruit).
Ces aléas peuvent générer des tsunamis, raz-de-marée de un à plusieurs dizaines de mètres : 40 m suite à l’éruption du Krakatoa en 1883, 30 m sur les côtes d’Alaska après le séisme de 1946, induisant d’autres aléas (inondations).
2°) Les aléas climatiques :
Les inondations sont aussi le fruit des précipitations qui, cumulées à la fonte des glaciers, génèrent des crues importantes. Si les littoraux ne sont pas les seuls espaces soumis à ce danger, la proximité des embouchures (qui concentrent les eaux du bassin hydrographique) augmente les risques.
De plus, les inondations peuvent résulter de vents violents de la ZIT (cyclones, ouragans, typhons…) ou des zones tempérées (tempêtes, tornades), comme le montre a posteriori les exemples de Katrina (2005) et Xinthia (2010).
Ces aléas accroissent les risques de glissements de terrain dans les régions montagneuses. Si cela ne concerne pas que les côtes, la dénivellation implique toutefois une plus grande intensité potentielle sur les littoraux (cf. Philippines).
3°) Les aléas anthropiques :
Or, la déforestation accentue les risques de mouvement de terrain, mais aussi de sécheresse. Les activités des hommes sont également mises en cause dans le réchauffement climatique. L’homme accroît parfois les aléas naturels.
De plus, par ses actes, volontaires ou non, l’homme constitue aussi des aléas anthropiques (directs cette fois) sur les long, moyen et court termes : maladies (pandémies), crimes (contre l’humanité), accidents (transports)…
Ainsi, on parle d’aléas technologiques lors du naufrage d’un supertanker (Erika, 1999), de l’explosion d’une plate-forme pétrolière (BP, 2010), générant des marées noires. C’est aussi vrai pour les risques générés par les industries nucléaires (Tchernobyl, 1986) ou chimiques (Sanofi Aventis, Vertolaye).
De nombreux aléas, d’origine naturelle et/ou anthropique (cumulatifs), à l’intensité et à la probabilité variées, pèsent non seulement sur les littoraux mais, plus globalement, sur tous les espaces, de l’échelle locale à l’échelle mondiale.